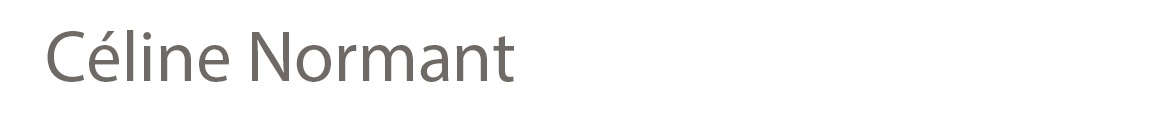Pouvez-vous, Céline, en guise d’entrée en matière, nous dire comment vous est venu le goût de peindre ? Vous classeriez vous dans la catégorie des doués de nature nés un pinceau ou un crayon à la main ou dans celle des « vocations tardives »?
J’ai commencé assez tard, vers 13 ans à dessiner , d’après des photos de magazines de mode. Puis j’ai suivi des cours de dessin et peinture avec une femme passionnante qui me lisait des citations de Cézanne, de Klee pendant que je travaillais d’après modèle, ce qui ne peut pas laisser indifférent ! J’ai appris à regarder ce qui m’entoure, à ne rien banaliser, c’est devenu philosophique, une façon d’habiter le monde, de chercher l’or des choses.
Et puis j’ai rencontré vers l’âge de 16 ans Max Figerou, sculpteur, dessinateur et pédagogue de génie, et alors plus rien n’a trouvé grâce à mes yeux que l’art, j’ai compris que consacrer ma vie à l’élaboration d’un langage plastique pour mettre en forme mes pensées, mon rapport au monde était la chose la plus sensée qui soit.
Le passage par la prestigieuse école des « Beaux-Arts » de Paris a été, semble-t-il, en même temps qu’une consécration, un temps d’affirmation, voire de confrontation : comment s’est passée votre scolarité ? Que vous a-t-elle appris ?
Il y a toujours des choses à prendre et à laisser, en tout cas ça m’a beaucoup bousculée, on a l’occasion de voir beaucoup de peintures, de tous les styles, alors on est tenté, on essaye, on se remet beaucoup en question, on est très stimulé visuellement, très influencé. La difficulté est de rester centré, de piquer des idées à gauche et à droite sans se perdre, sans tomber dans l’effet, toujours rester concentré sur le sens que l’on veut donner à son travail. En cela c’est une bonne école, cette surabondance, cette variété vous pousse à vous affirmer sinon vous n’existez plus, vous êtes noyé. Par contre il faut être solide parce qu’il y autant d’avis que de professeurs et ils ne sont pas tous tendres ! J’ai eu la chance de tomber sur Pat Andrea qui m’a suivi pendant ces 5 ans, il a su me mettre en danger mais aussi m’encourager.
Ce sont des années importantes parce que ce sont les premières que l’on consacre exclusivement à sont travail, on a la possibilité d’échanger avec les professeurs et élèves, ça peut être décisif, après on est très seul, mais il ne faut pas oublier qu’ élaborer un langage plastique ne se fait pas en 5 ans, une école est aussi une bulle dont il faut sortir, ce n’est qu’un début.
Je reviens sur Pat Andrea, votre maître d’atelier, parce qu’il me semble avoir eu sur vous une influence déterminante, même si, comme vous venez de nous le dire, vous avez dû ensuite chercher votre voie propre. Qu’avez-vous à en dire ?
Le lien que l’on tisse avec un enseignant dans cette discipline particulière est complexe, faite d’admiration et de la nécessité absolue de se positionner, de développer une œuvre personnelle, c’est un équilibre délicat. Il y a eu une période où je regardais beaucoup le travail de Pat, j’aime beaucoup son éclectisme, ses trouvailles formelles, ses dessins d’Alice au pays des merveilles sont d’une inventivité extraordinaire, les mélanges de fusain, de crayons de couleur, d’aplats, de collages, les mouvement arrêtés des personnages et son style unique, tout ça me donnait des idées. Mais Pat n’était pas un professeur écrasant qui vous impose sa manière, au contraire il était très curieux et enthousiaste de découvrir l’univers et les inventions de ses élèves. Il m’a appris à prendre des risques, à être plus audacieuse et ce qui n’est pas rien m’a encouragée à développer un travail d’imagination, il appelait ça « la représentation de l’imaginaire « .
Un professeur compte autant qu’un peintre du passé, à force de les regarder on mémorise, on absorbe sans même s’en apercevoir des rapports colorés, une façon de poser la touche, un climat, une façon d’amener une couleur, de la faire chanter, un style de dessin, ça nourrit notre travail. On picore jusqu’à ce que l’on trouve son naturel. Les carnations et la plastique des femmes d’Ingres, le chatoiement des couleurs d’Odilon Redon, les compositions savantes de Balthus, ses dessins ont été des objets de fascination pour moi.
Vous poursuivez un parcours original, dans le monde des arts plastiques d’aujourd’hui, sans trop vous soucier des modes, et des tabous. Mais il y a des filiations des parentés, des affinités inévitables et souhaitables. Quelles sont vos références picturales actuelles, et passées ?
Les maîtres du passé que j’aime sont tellement nombreux que je ne pourrais pas les citer tous, disons, en plus des trois déjà évoqués, les peintres et dessinateurs allemands du 16è siècle, Dürer, Grûnewald, Schongauer, pendant la réalisation de certaines toiles exposées ici j’ai beaucoup pensé à Gauguin, à Gérard Garouste, à Pat Andrea et plus récemment à Ronan Barrot qui est sorti des Beaux-arts peu de temps avant moi. Quand je peins les petits formats c’est au travail de Max Figerou que je pense beaucoup, il est d’une grande profondeur.
La musique classique est très importante, je me sens des affinités avec l’esprit d’ Offenbach, dont je peux écouter les opérettes en boucle, elle rythme mes séances de travail, ça m’aide à plonger en moi, il compte beaucoup, autant que les grands peintres. Certains écrivains aussi, en ce moment Romain Gary, mais aussi Fred Vargas !
J’ai été très vite frappé, en regardant vos toiles, par une certaine forme de « radicalité » de votre travail, en ce sens que vos toiles aspirent à créer leur temporalité et leur univers propres, et paraissent plutôt un aboutissement qu’un processus, à rebours d’un des dogmes des arts plastiques d’aujourd’hui, l’instantané, le fugitif, le mouvement. Est-ce une approche juste ?
C’est juste mais c’est le processus qui amène cette temporalité propre. Chaque peinture est la cristallisation d’une pensée. Or une pensée est tissée de contradictions, de certitudes, de doutes, de flottement, nous sommes travarsés de peurs et de jubilations, de souvenirs et d’aspirations, et la représentation ou l’évocation de cette complexité, l’accord entre tout ça ne peut-être que suspendu dans le temps. Il y a quelque chose d’évanescent dans l’équilibre trouvé. La peinture est un processus, pas l’illustration d’une idée. Aussi quand je travaille je commence par une couleur ou le dessin d’un personnage et je laisse mes pensées vagabonder, elles soulèvent des émotions, des questions sans réponses précises ou des histoires qui m’amènent à associer d’autres éléments, je me sers de l’aléatoire, des accidents de dessin, des coulures, je ne fige rien, le tableau s’enrichit, s’étoffe de ce dialogue avec moi-même, et le sens se précise et guide ensuite mes choix de façon plus consciente jusqu’à trouver sa forme dans un équilibre suspendu. Il y a donc un parallèle entre le processus de création et la nature d’une pensée.
Chacune de vos toiles nous raconte une histoire. D’abord êtes-vous d’accord avec cette affirmation et comment vous viennent vos inspirations ?
Une histoire n’est pas tout à fait le mot juste, mais plutôt un état, une pensée comme je vous le disais.
Quant à l’inspiration…c’est beaucoup d’acharnement ! Dans un premier temps je me sers de photos, soit des magazines, soit des photos personnelles, je fais poser des amies, je prends des centaines de photos et après un long tri qui déjà me plonge dans mes pensées, j’en choisi quelques- unes qui seront mon point de départ. Les associations que je fais alors sont difficiles à expliquer, oui je me raconte des bribes d’ histoires mais je ne fais que les évoquer sur la toile, je n’en dis que ce qui est suffisant pour ne pas en faire une anecdote, pour n’en dire que l’état, les pensées dans lesquelles elles me plongent. Léonard de Vinci a dit « le peintre a essentiellement deux choses à représenter, le personnage et le contenu de sa pensée ».
Mon intention bien sûr est de rendre palpable la tension, la douceur, la joie, la mélancolie ou la colère que soulèvent ces évocations de manière à les rendre partageables . Pour cela je ne dois pas enfermer le spectateur dans l’illustration d’une histoire en particulier, dans une temporalité trop précise, mais établir une distanciation.
La femme y est très présente, et pas seulement comme un modèle ; pourquoi cette insistance, et quelle valeur lui attribuez-vous sur le plan pictural ?
Peindre une femme c’est implicitement peindre ce qu’elle donne à voir à l’homme. Que comprends-t-elle de sa sexualité , de ses pulsions, de son rôle ? Je mets en scène la dualité, la difficulté de concilier une sociabilité qui passe par une maîtrise de soi, une éducation et la nécessité de retrouver un feu, une sauvagerie, une intuition, des instincts qui de toutes façons réclament régulièrement leurs droits. De façon plus vaste retrouver le lien sensuel, physique, instinctif à la vie, le lien brutal, bestial avec une part plus animale.
Une des femmes avec laquelle votre imaginaire s’est senti le plus en résonance a été et est peut-être encore Clarissa Pinkola Estès : dites-moi dans quel sens, ce qui revient à poser la question du rapport entre l’écrivain et le peintre : quel langage commun ?
La lecture de son livre « Femmes qui courent avec les loups » a été un déclencheur puissant, son analyse des mythes et légendes qui parlent de la nature sauvage, profonde de la femme, de l’inconscient collectif féminin était en parfaite adéquation avec ce que j’essayais d’exprimer. D’abord j’ai eu la confirmation que ce qui nous est profondément intime est universel , elle met notamment en évidence qu’ il y a des schémas communs entre des contes de sociétés géographiquement très éloignées ce qui prouve que nous partageons au-delà des contextes culturels une subjectivité commune. Cela signifie dans le langage plastique, que l’introspection nous relie à l’universel . Ensuite c’est la forme narrative du conte qui m’a intéressée, il y a l’histoire et le sens caché de cette histoire, son symbolisme, ce qui est donné à voir et le double sens. Le fait aussi que chaque personnage du conte soit un élément de la psyché, donc que l’on est multiple. Le lien entre les lieux, la forêt en particulier, les sous-bois et la psyché. Enfin je retrouve dans l’indifférence aux injonctions du temps des points communs avec la peinture, le temps psychique est malléable, s’étire ou se suspend.
Vous êtes depuis quelque temps à un tournant dans votre inspiration et, cela se sent dans vos dernières toiles, où la thématique s’élargit à d’autres cadres géographiques – la forêt, l’Asie-, devenant plus complexe. S’agit-il pour vous d’un choix conscient, délibéré ?
J’ai visité le Vietnam et le Cambodge et j’ai été très touchée par le lien étroit qu’ils entretiennent avec la nature, tout ce qui pousse est utilisé, de la racine à la fleur, ils exploitent à fond les richesses naturelles, leur vie est entrelacée à elle et elle est abondante, luxuriante, généreuse dans ses dimensions, la forêt est partout. Les vaches, les chèvres, les poules se promènent dans les rues, je trouve ça très rassurant, très apaisant, comme si ça laissait plus de place justement à notre animalité. Je me sers de ces souvenirs donc pour évoquer un accord entre notre part animale, bestiale et cette abondance, cette omniprésence de la nature, sous sa forme végétale ou animale.
Quelles sont vos prochaines pistes de travail, de recherche, n’étant pas, à mon avis, de ceux qui s’enferment dans un style pour n’en pas démordre ?
La femme que je suis ne cesse d’évoluer, donc ma peinture aussi. Il faut rentrer dans son monde intérieur avec le plus d’authenticité possible.
Questions posées par Nicolas Mettra.