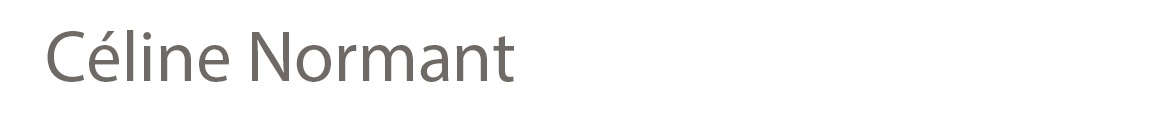Passer au contenu
Propos de Max Figerou
Je travaille depuis un bon moment avec Céline, nous échangeons souvent sur les complexités du
travail, la place de la figure, le sujet , le sens de ces questions qui taraudent nécessairement tout artiste qui veut nouer une pensée à l’acte du langage.
Une exposition est un moment qui appartient beaucoup à ceux qui vont se confronter à l’œuvre, aux gens qui vont devant le tableau laisser monter des affinités, essayer de trouver un chemin d’identité avec ce qui leur ai raconté.
C’est une chimie bien intéressante que de voir une sensibilité exprimée, toucher des êtres, et de comprendre ainsi que nous sommes dans le fond organisés autour du même destin.
Mais pour un artiste, c’est aussi un moment de recul, l’occasion d’une sorte de synthèse, et Céline
m’a demandé de dresser une forme de géographie du chemin parcouru. Je la dresse bien volontiers, non pas pour expliquer l’œuvre, mais pour le plaisir de comprendre combien un langage peut être tissé à un être, à ses méandres, à sa singularité, mais, précisément, parce-que cette singularité personnelle est traduite en langage, cette question si personnelle devient un fait qui d’une façon ou d’une autre, est celui que nous partageons.
Petit schéma rapide des conditions d’exercice de l’action poétique
Aujourd’hui, on fixe comme « mission » aux peintres d’avoir une originalité, de dégager une sorte de propos singulier. On leur réclame une nouveauté, un peu comme on réclame à une collection de haute couture d’une année sur l’autre une orientation nouvelle, on fixe des attentes qui ont un net caractère publicitaire, une sorte de cahier des charges flatteur pour l’égo social.
Cette charge publicitaire a comme conséquences d’exaspérer, d’extérioriser l’écriture sensible que peut déployer un artiste, de le priver de la plongée dans l’édifice intérieur, de prendre le temps de rencontrer ses affinités, ses paternités, sans préjuger du résultat.
Le temps et la sorcellerie dans cette quête sont incompatibles avec la hâte publicitaire d’aujourd’hui.
En lui réclamant dès sa formation de démontrer socialement qu’il est original, nouveau, et utile comme tout bon produit, on le coupe de son naturel en le plaçant hors de lui-même. Entraîné dans la ronde mercantile, et acteur d’une mise en scène dont le propos sert finalement à en faire un chroniqueur social, a comme conséquence une extériorisation de son écriture.
Pour le rassurer, on fait de cette extériorisation une vertu, on nous dit que l’écriture ne doit pas être trop sensible, trop personnelle, on rompt ainsi la chaîne entre ce qu’il y a de commun et ce qui est individuel, comme s’ il ne pouvait y avoir de vision commune qui n’ai d’abord pris racine dans une expérience personnelle, dans un monologue intimiste aux racines inconscientes.
Tout démarre de cet appareillage intérieur qui est projeté grâce à sa traduction dans le langage, pour postuler au partage. En synthèse, cette formule peut résumer ce qui nous lie comme ceci: nous ne sommes pas une addition d’individus, mais nous sommes une humanité.
Toute expérience personnelle, aussi singulière soit-elle rejoint le tronc commun, et l’art est de rendre visionnaire le chemin qui part d’un point singulier et maillon après maillon, nous fait comprendre ce qu’il y a d’éminemment partagé jusqu’à forger grâce au langage sensible de l’action poétique, un destin commun, destin si particulier, si commun.
L’introspection est vue, en ce moment, comme un méandre sans intérêt pour les autres, impartageable, inutile socialement: Pas de projection, pas de désir, juste un façonnage avec des matériaux plus ou moins chers, de figures fréquentées par tout le monde dans l’ordinaire des jours.
Il y a là une exploitation à outrance d’idées de toutes sortes, mais y a t il du sens? L’idée et le sens remplissent ils la même fonction?
L’idée est une situation contingente (je marche, je mange une religieuse au chocolat), cependant une œuvre qui n’en serait que la stricte illustration, sa réalisation et rien au delà, ne peut être considérée que comme le résumé mis en forme d’un schéma préétabli sans contrepied, souvent sans paradoxe: c’est une œuvre qui montre mais qui n’exprime pas.
Des œuvres qui montrent, au musée d’Orsay nous en avons plein, La décadence romaine par exemple, tout y est : la sandale, la toge, les seins, les fesses, les flacons d’alcools, tout ce que nous pouvons nous faire comme idée de la décadence romaine.
Cette forme de peinture est caractérisée comme étant académique.
Aujourd’hui, on privilégie ce qui « montre » seulement, et le chant expressif est perçu comme superflu, coquetterie d’un autre âge, précisément la question est de savoir ce qu’amène à partir d’une idée parfois nécessaire comme déclencheur, la projection personnelle en tant qu’individu, ce qu’une idée lève chez nous. Si elle est un levier, elle ne peut que lever toutes les anguilles sous la roche, ces anguilles sont nos souvenirs, les peurs, les sentiments qu’on a du monde, les forces que ces idées réveillent, les faiblesses sur lesquelles elles appuient, bref, tout ce que cela réveille et révèle.
Un autre aspect qui nécessairement justifie la projection individuelle (chant expressif) c’est la caractérisation anatomique de ce qu’est une pensée, une pensée est-elle une idée?
Pour moi, non. Une idée ne peut être qu’un fragment de pensée, une pensée est un lieu de forte concentration, d’éléments très divers du passé vécu, du passé non vécu, de peurs, d’espoirs, c’est un petit peu le syndrome du siphon qui concentre et attire à lui, tous les éléments du grand bain. Parmi ces éléments, une idée peut servir à s’orienter, guère plus.
Une pensée, c’est plus vaste, plus paradoxale, ça fait cohabiter des éléments et des temps qui dans l’ordinaire des jours ne sont pas faits pour se rencontrer, mais qui dans notre expérience, finalement, peuvent se nouer, puisqu’ils nous habitent, grâce à la transposition du langage, et arrivent à forger une certaine cohérence.
L’idée installe les évidences proches, la pensée rassemble des paradoxes profonds.
La pensée donne du sens, le sens échappe à l’idée, c’est l’indicible de la réalité, le sens se sert du contingent pour poser sa respiration, sa profondeur, pour proposer une image du temps.
Petit tableau, chambre noire
La figure, la gourmandise
Le travail de Céline soulève des problèmes touchant à la cohérence entre la personne, ses méandres, le langage, et le monde.
On peut appeler cette continuité ininterrompue comme étant la question de l’accord.
Toute œuvre conséquente doit d’abord être une révélation à soi-même. Céline, me semble t-il, cherche à se révéler à elle-même, en tout premier lieu, des formes dans des écritures qui puissent lui permettre d’être visionnaire des contradictions qui l’habitent. Si on s’amusait à trouver une synthèse, nous pourrions l’exprimer comme cela: Céline cherche des formes pour chevaucher son naturel puissant.
Il y a deux chemins très clivés dans sa peinture, une façon baroque mais assez synthétique de poser en quelque sorte l’éternel féminin, et d’exposer cette énergie féminine au milieu des éléments: les tissus, les animaux, les plantes, les fleurs, les paysages, les états d’âme, les cris, les colères, une façon aussi d’interroger la figure complémentaire, l’éternel masculin. Cette profusion rythmique tisse un lien indicible entre les actions, les forces des éléments du monde, ses rumeurs, et le corps comme récepteur exemplaire, par ailleurs auteur de sa projection.
Le corps est l’œil du sablier par où cheminent les temps du monde, sang des éléments, pour chercher l’accord avec les visages, les temps constitutionnels du corps qui fourmillent dans l’édifice psychique.
Il y a dans ses tableaux beaucoup d’action, du vacarme même, dans une écriture polie, parce-que les questions qui habitent Céline portent sur sa façon d’être dans le monde: « quelle femme est-elle? » Mais cette question éminemment personnelle posée dans un tableau, donc un langage, devient « qu’est-ce qu’une femme? ». Il y a une véritable question qui la hante, qu’elle interroge avec ornement, comme pour rendre gourmande l’âpre question.
La gourmandise est une des matières identitaires de Céline, son physique puissant, sensuel, est un aspect non négligeable dans son écriture, car un artiste agit aussi à l’écho de son physique, les forces, l’ampleur et ses limites en font un élément très actif dans l’action poétique, c’est le premier lieu récepteur, le tamis qui filtre l’époque et retiens le temps, plus ou moins, dans une énergie toujours singulière. Il va colorer la pensée par l’équilibre que son déploiement, comme matière vivante, va nouer avec la mort, qui est la figure correspondante au sourire vivant, au cri désireux. Tout cela est animal, intuitif, et influe. Celui de Céline est très puissant, quel accord trouve-elle avec celui-ci?
Un autre aspect de son œuvre profondément lié et pourtant apparemment lointain, sont ses visions plus âpres, plus pulsionnelles peut-être, moins raisonnées, volcaniques, laissant voir une certaine sauvagerie éruptive qui illustre un aspect profond chez mon amie, et construit une œuvre parallèle, ces aperçus que j’ai situé dans la chambre noire sont des visions très archaïques, qui viennent du fond de l’ébullition physique, où se fondent, très contrastées, le mélange particulier des éléments qui construisent notre existence au sens premier, et sont aussi au même moment ceux de notre anéantissement; les petits tableaux des Céline viennent de cette chambre noire, ou s’il on veut de la forge caverneuse, et en sont l’émergence la plus directe qui racontent sans la correction de la philosophie, sans l’orientation de l’idée, la pulsion vivante prise en instantané dans les filets du temps.
La grande matière de l’accord que cherche à poser Céline à l’aune d’une trilogie complexe: 1. son tempérament, 2. son physique, 3. sa pensée, espère construire une unité que l’on peut appeler un moment de vérité.
Ce dialogue intime, fondateur, pour toutes questions communes, cette recherche d’une unité, avec comme ciment la pensée, est la seule ambition qui vaille aujourd’hui pour forger un langage conséquent, qui puisse toucher. Ce sont des questions que nous avons tous en partage, Kubin a voyagé douloureusement dans ses pensées, a montré le naufrage que l’affect pouvait produire sur l’intégrité personnelle, quel vent destructeur la passion pouvait faire souffler sur un être et le faire sombrer.
Céline n’a pas vraiment ce pessimisme, bien qu’elle est quelques inquiétudes dans tout cela. Cette double écriture que son esprit forge, ses tableaux où les figures dessinent des actes énigmatiques et passionnels, et ses petits tableaux sans apprêts où la chaleur du tempérament laissent apparaître des cristallisations à peine visibles, sont la manifestation d’une qualité spirituelle dans son action, elle ne décrète pas une unité d’être et de penser, elle ne s’arrête pas à des idées toutes formulées, mais elle cherche du sens dans son œuvre, qui puisse lui faire entrevoir un moment de vérité. Il y a nécessairement dans cette quête des complexités, des moments où l’on se sent très seuls, précisément parce-que l’on commence par soi, et que toute pensée qui s’adresse aux autres sans commencer par soi, est une pensée inhabitée.
Le champ d’action de Céline n’étant pas cerné par le formalisme stylistique, est immense.
Elle forge avec une totale sincérité et une force de tempérament une écriture qui puisse installer un équilibre.
Il y a aujourd’hui deux rivages, elle forgera sans doute des ponts entre ces rivages. C’est le vagabondage de son œuvre qui nous le dira, son travail est aventureux et cherche peu à limiter la projection par quelques formules esthétiques rassurantes.
Pour moi, le mot qui résume le mieux son action poétique, c’est le mot Accord.
Max Figerou.